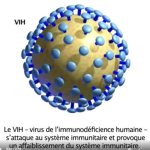VIH-SIDA
TÉMOIGNAGES

«Notre but: 90% des personnes porteuses du VIH diagnostiquées en 2020»
Pr Stéphane De Wit, Chef de Service des Maladies Infectieuses au CHU Saint-Pierre
Pour mettre fin à l’épidémie de sida dans le monde, l’OMS a défini une cible ambitieuse pour 2020: 90% des personnes vivant avec le VIH devront être dépistées, 90% des personnes diagnostiquées devront recevoir un traitement antirétroviral durable et 90% des personnes traitées devront avoir une charge virale durablement supprimée. En Belgique, l’accent est mis sur le dépistage.
La cible: diminuer l’épidémie cachée
«La prise en charge du VIH en Belgique, comme dans de nombreux pays européens, est efficace: aujourd’hui plus de 90% des patients diagnostiqués reçoivent un traitement antirétroviral et, parmi ceux-ci, 90% au moins ont une charge virale indétectable. Notre point faible est le dépistage: on estime que 15 à 20% des personnes séropositives s’ignorent. C’est ce qu’on appelle l’épidémie cachée», explique le Pr de Wit. «Nos efforts doivent se concentrer sur ce volet pour faire en sorte qu’au moins 90% des personnes infectées connaissent leur statut. Une fois dépistées, les personnes séropositives peuvent recevoir un traitement antirétroviral et contrôler leur charge virale. Le dépistage et la prise en charge qui s’en suit représentent donc un bénéfice pour l’individu mais aussi pour la communauté, puisqu’un patient en suppression virologique ne transmet plus le virus.»
Mieux cibler les populations à risque
«Dans notre pays, quelque 600.000 tests de dépistage sont réalisés chaque année. Nous effectuons beaucoup de tests. Le problème est que nous ne ciblons pas suffisamment les deux plus grands groupes d’intérêt, à savoir les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et les migrants essentiellement d’origine subsaharienne. Nous allons par exemple réaliser un test de dépistage en préopératoire chez une personne âgée qui se fait opérer de la cataracte: la probabilité que ce patient soit séropositif reste faible par rapport aux populations à risque!».
Les freins au dépistage
«L’épidémie cachée en Belgique est associée à un taux de dépistage tardif de 30-35%. Les freins au dépistage – et au dépistage précoce – sont de plusieurs sortes:
- Au niveau médical, il y a encore trop d’opportunités manquées. Il arrive que des patients qui devraient subir un dépistage pour une raison médicale ne soient pas dépistés. C’est notamment le cas de patients présentant une maladie sentinelle (maladie pour laquelle au moins 1% des patients sont séropositifs. C’est le cas de la dermatite séborrhéique, mais aussi de l’hépatite B, C, des autres IST, de la tuberculose, du zona…) qui devraient systématiquement être testés.
- L’accès à des structures faciles de dépistage est restreint. Actuellement, il n’existe par exemple que 3 centres de dépistage anonymes et gratuits en Belgique (Anvers, Bruxelles et Liège).
- Il existe un réel déficit dans l’éducation sexuelle et affective des publics jeunes.
- De nombreux freins socio-culturels sont présents dans notre société, comme le tabou qui règne autour de la maladie, le rejet, la peur de ce rejet, la stigmatisation… Ces freins sont encore plus importants dans les populations d’Afrique subsaharienne.»
Quels outils pour un ciblage efficace?
«Deux outils sont actuellement mis en place pour faciliter l’accès au dépistage. L’autotest à orientation diagnostique est depuis peu disponible en pharmacie. C’est un outil efficace qui va certainement contribuer à un plus grand nombre de dépistages. Malheureusement, ce test dont le prix est de 30 € n’est pas remboursé par la mutuelle et exclut donc une partie de la population à risque, comme les migrants qui ont d’autres priorités financières. L’autre outil important en passe d’être déployé est le dépistage démédicalisé (sans la présence obligatoire d’un médecin) et délocalisé. Le but de ce dépistage est d’aller vers les populations à risque plutôt qu’attendre qu’elles viennent à nous. À l’image de certaines collectes de sang qui s’organisent sur des lieux d’intérêt, nous allons aussi pouvoir aller là où les personnes à risque sont présentes en grand nombre: dans les boîtes de nuit gay, sur des évènements comme la gay pride, des fêtes africaines… On pourra le faire avec des groupes de la communauté, des activistes, des groupes de soutien qui s’impliquent dans cette cause.»
Partager et imprimer cet article
NEWS
 18 07 2025
18 07 2025
VIH-SIDA
Loreen Willenberg: vers une guérison naturelle du VIH?
Alors que Loreen Willenberg a récemment subi une immunothérapie intensive pour traiter des cancers du poumon et du cerveau, aucun rebond viral n’a été détecté, renforçant...
Lire la suite 22 08 2024
22 08 2024
VIH-SIDA
VIH: la stigmatisation vécue par le patient
Les résultats de ce sondage systématique ont surpris bon nombre de professionnels de la santé lorsqu’ils ont constaté l’ampleur du ressenti de la stigmatisation. 91% des...
Lire la suite 30 11 2021
30 11 2021
VIH-SIDA
SIDA (VIH): nombre inquiétant d'infections non diagnostiquées
Selon un nouveau rapport de l’OMS, le nombre de nouveaux cas de VIH diagnostiqués entre 2019 et 2020 aurait baissé de 24 %. Cette baisse serait en grande partie due à la...
Lire la suite 29 03 2019
29 03 2019
VIH-SIDA
Unity: un guide pour aider les patients séropositifs à se confier à leur médecin
À l’hôpital, les personnes séropositives sont suivies par un médecin spécialiste du VIH ainsi qu’une équipe paramédicale (psychologue, diététicien(ne), infirmier(-ère) VI...
Lire la suiteVOS ARTICLES PRÉFÉRÉS
VIH-SIDA
De moins en moins de sexe?
Plusieurs études, venant pour la plupart des États-Unis mais pas seulement, indiquent que nous avons de moins en moins de relations sexuelles.
Aux USA, 23% des adultes d...
MALADIES À LA UNE
Cancer de l'estomac
Covid-19
Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
Greffe d'organes
Leucémie myéloïde chronique
Migraine et maux de tête
Oeil infecté, irrité ou sec
Vessie hyperactive
PRÉVENTION À LA UNE
Toutes les thématiquesNEWSLETTER
MALADIES LIÉES
DépressionEN IMAGES
EN VIDEOS