News
NEWS

Publié le 04/11/2019 à 09:45
La prophylaxie: un atout indispensable pour protéger les articulations des hémophiles
Aujourd’hui, l’intérêt de la prophylaxie pour prévenir les complications articulaires de l’hémophilie ne fait plus aucun doute. Et ce d’autant plus que les traitements ont profité de progrès considérables et que les perspectives thérapeutiques à venir sont prometteuses.
Si l’hémophilie est une maladie sanguine, ses conséquences sont surtout potentiellement néfastes pour certaines articulations des patients. En cause: la survenue répétée de saignements articulaires, principalement au niveau des chevilles, des genoux et des coudes. La plupart du temps, il s’agit de saignements spontanés, dont la cause n’est pas clairement identifiée. Il peut suffire d’un choc mineur ou d’un faux mouvement pour que l’articulation se mette à saigner de manière prolongée.
Ces saignements répétés au niveau des articulations peuvent endommager durablement le cartilage, entraînant douleurs et déformations articulaires parfois irréversibles. On parle alors d’arthropathie hémophilique. Ce type d’atteinte peut apparaître dès l’enfance et progresser à bas bruit tout au long de la vie du patient. D’où l’intérêt des traitements dits «prophylactiques», qui permettent de diminuer drastiquement la fréquence de ces saignements et de prévenir les complications articulaires.
La prophylaxie en pratique
Chez les patients atteints d’une forme modérée à sévère d’hémophilie, le traitement prophylactique consiste en l’auto-injection systématique et régulière du facteur de coagulation déficient par voie intraveineuse. La fréquence d’administration du traitement varie d’un patient à l’autre, en fonction notamment du type d’hémophilie et du risque de saignement, mais aussi de la durée de vie du produit injecté.
On parle de prophylaxie primaire quand le traitement débute dès la petite enfance ou immédiatement après un premier épisode hémorragique, et de prophylaxie secondaire quand les injections sont proposées après quelques épisodes hémorragiques. La prophylaxie primaire est l’approche privilégiée ces dernières années. Il a en effet été prouvé qu’un traitement précoce constituait l’option la plus efficace pour prévenir les complications articulaires de l’hémophilie.1 On estime que ce type de thérapie permet de réduire les saignements de plus de 90%. À l’heure actuelle, ces traitements ne permettent cependant pas de guérir la maladie. Les injections doivent dont être administrées à vie.
Prophylaxie: progrès et perspectives
Alors qu’il y a encore quelques années, les déformations articulaires étaient fréquentes chez les patients hémophiles, on observe aujourd’hui une diminution considérable de ces complications grâce aux traitements prophylactiques. Les produits administrés sont de plus en plus performants et leur durée d’action prolongée permet de réduire le nombre d’injections nécessaire.
Dans les années à venir, d’autres avancées thérapeutiques sont à prévoir. Certains traitements seront par exemple injectés non plus par voie intraveineuse, mais bien en sous-cutané.
La thérapie «génique» laisse également présager des résultats prometteurs. Le principe? Doter les patients d’une correction de l’erreur génétique pour leur permettre de produire les facteurs de coagulation déficients. Une thérapie novatrice qui vise donc la guérison de la maladie! Cette piste thérapeutique fait actuellement l’objet d’essais cliniques en Belgique.
Partager et imprimer cet article
NEWS
 16 02 2026
16 02 2026
Hypertension
Montres connectées et dépistage de l’hypertension: quel impact?
Cette fonctionnalité repose sur des mesures optiques, via l’analyse de signaux émis par la montre connectée (dits de photopléthysmographie) et vise à alerter l’utilisateu...
Lire la suite 09 02 2026
09 02 2026
Alcoolisme
L’alcool plus souvent en cause dans les suicides de femmes LGB
Les auteurs ont exploité les données du National Violent Death Reporting System entre 2013 et 2021, en identifiant l’orientation sexuelle à partir des rapports de police,...
Lire la suite 02 02 2026
02 02 2026
Diabète
Tennis: pour Zverev, chaque match se joue aussi contre le diabète
Atteint d’un diabète de type 1 diagnostiqué à l’âge de 4 ans, le numéro 3 mondial explique vivre «deux matchs en même temps»: celui que tout le monde voit, et celui, invi...
Lire la suite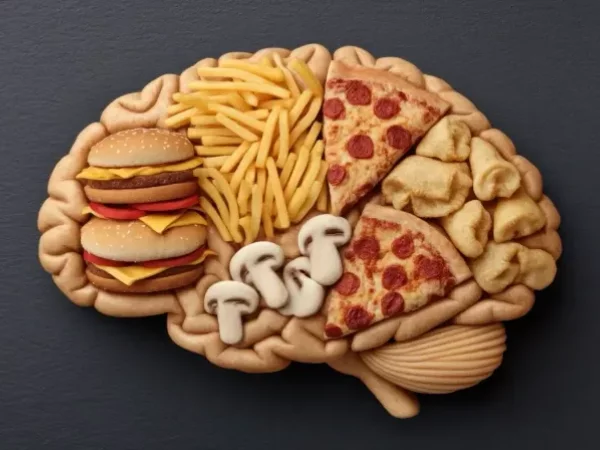 26 01 2026
26 01 2026
Obésité
Obésité: une maladie du cerveau avant d’être une question de volonté
Au cœur de ce processus se trouve l’hypothalamus, véritable centre de régulation de la faim et de la dépense énergétique. Quand le poids baisse, il réagit comme à une men...
Lire la suiteVOS ARTICLES PRÉFÉRÉS
BRÈVES
SONDAGE
TÉMOIGNAGES
«Comment être mieux sensibilisés au cancer du poumon?»

Entretien avec la Pre Sebahat Ocak, pneumo-oncologue thoracique (CHU UCL Namur, Godinne), et avec Marie-Ange, patiente atteinte de cancer pulmonaire et membre de l’association ALK+ Belgium.
«Sclérose en plaques: l’importance du diagnostic»

Le Pr Souraya El Sankari (Service de neurologie, Cliniques Universitaires St-Luc) revient sur l’importance du diagnostic pour la bonne prise en charge de la sclérose en plaques.
«SGC-II: cette affection méconnue ne doit pas vous empêcher de vivre!»

Professeur Tim Vanuytsel (UZ Leuven)
MALADIES À LA UNE
Alzheimer
Covid-19
Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
Greffe d'organes
Leucémie myéloïde chronique
Migraine et maux de tête
Oeil infecté, irrité ou sec
Vessie hyperactive
PRÉVENTION À LA UNE
Toutes les thématiquesNEWSLETTER
MALADIES LIÉES
EN IMAGES
EN VIDEOS













