Malaria
Symptômes
1. Malaria: des symptômes peu spécifiques

Poussées de fièvre
La malaria se manifeste souvent par des poussées intermittentes et aiguës de fièvre (40 à 41°). Ces épisodes sont typiquement accompagnés de:
- de tremblements,
- de sueurs froides et
- d'une transpiration intense.
Ils sont appelés «accès palustre». D'autres symptômes peuvent être présents mais ils sont peu spécifiques: maux de tête, douleurs musculaires, nausées... Ainsi, la malaria peut facilement être interprétée comme un début de grippe. Au retour d'un voyage lointain, ces symptômes doivent donc éveiller la vigilance.
Des symptômes récurrents
La crise de paludisme ou accès palustre se caractérise par de fortes fièvres survenant de manière cyclique: toutes les 24 heures, tous les deux jours ou tous les trois jours, selon le type de parasite. Les accès palustres peuvent se répéter pendant des mois ou des années, en raison de formes hépatiques «dormantes» du parasite.
Article rédigé avec la collaboration du Dr Umberto d'Alessandro (Institut de Médecine Tropicale d'Anvers)
2. Premiers symptômes de la malaria

Période d'incubation
Le moustique anophèle femelle injecte dans le sang humain, via sa salive, le parasite sous forme d'une cellule appelée «sporozoïte». Celle-ci va rapidement se diriger vers le foie, où elle va se multiplier (pendant une à trois semaines) pour donner naissance à des dizaines de milliers de nouveaux parasites, appelés «mérozoïtes».
Les premiers symptômes de la malaria
Ces millions de parasites quittent ensuite le foie pour pénétrer dans les globules rouges. Ils vont y suivre un autre cycle de reproduction. Au terme de ce cycle, les globules rouges éclatent et libèrent des nouveaux parasites, qui vont à leur tour envahir d'autres globules rouges. C'est à ce stade qu'apparaissent les premiers symptômes de la malaria, soit en moyenne deux semaines après la piqûre du moustique infecté. Les fièvres cycliques que l'on observe dans la malaria correspondent à ces ruptures successives de globules rouges.
De l'être humain aux moustiques
Des parasites sexués mâles et femelles (gamétocytes) vont se former à l'intérieur des globules rouges. Lorsqu'un moustique pique une personne infectée, il ingère ces gamétocytes, qui vont à leur tour donner naissance à des sporozoïtes. Ceux-ci migrent alors vers les glandes salivaires du moustique. Un nouveau cycle peut commencer.
Article rédigé avec la collaboration du Dr Umberto d'Alessandro (Institut de Médecine Tropicale d'Anvers)
VOS ARTICLES PRÉFÉRÉS
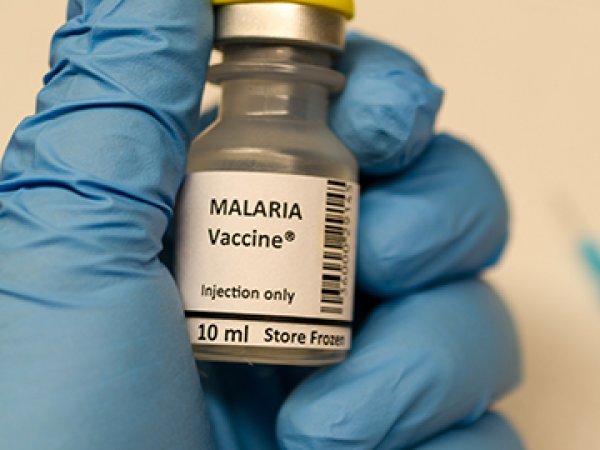 30 04 2014
30 04 2014
Malaria
Bientôt un premier vaccin antipaludique?
Un premier vaccin expérimental contre la malaria, le RTS,S/AS01, a démontré une efficacité vaccinale de 50% (14 mois après la première dose) chez des enfants âgés de 5 à...
Lire la suite 24 02 2011
24 02 2011
Malaria
Malaria: des symptômes peu spécifiques
Poussées de fièvre
La malaria se manifeste souvent par des poussées intermittentes et aiguës de fièvre (40 à 41°). Ces épisodes sont typiquement accompagnés de:
- ...
 24 02 2011
24 02 2011
Malaria
Examen sanguin pour détecter la malaria
Actuellement, la manière la plus fiable et la plus économique de réaliser un diagnostic de la malaria est l'examen microscopique d'une goutte de sang, appelée «goutte é...
Lire la suite 24 02 2011
24 02 2011
Malaria
Le test de diagnostic rapide (TDR)
Une alternative de terrain
Les tests de diagnostic rapide constituent une alternative très intéressante à l'examen du sang au microscope. Dans les zones à risque, ces t...
Lire la suiteSONDAGE
TÉMOIGNAGES
MALADIES À LA UNE
Cancer de l'estomac
Covid-19
Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)
Greffe d'organes
Leucémie myéloïde chronique
Migraine et maux de tête
Oeil infecté, irrité ou sec
Vessie hyperactive
PRÉVENTION À LA UNE
Toutes les thématiquesNEWSLETTER
EN IMAGES











